| |
« A
New Old Play » de Qiu Jiongjiong : l’opéra du Sichuan
revisité comme mémoire populaire
par
Brigitte Duzan, 18 juin 2025
Premier long métrage de fiction de
Qiu Jiongjiong (邱炯炯),
« A New Old Play » (《椒麻堂会》)
a commencé sa carrière en obtenant le prix spécial du jury
au festival de Locarno en août 2021. Il a poursuivi avec,
entre autres, le prix du jury du festival des
Trois-Continents à Nantes en novembre 2021 et le prix
FIPRESCI au festival de Hong Kong en août 2022. Sorti sur
les écrans français le 11 juin 2025 grâce au distributeur
Carlotta Films,
le film a – comme ailleurs – remporté l’adhésion
enthousiaste du public comme des critiques qui ont pu le
voir.
| |

A New Old Play |
|
On
peut résumer l’histoire en quelques mots rapides : un grand
acteur de l’opéra du Sichuan vient de mourir et se retrouve
à la porte du monde des enfers ; accueilli par les deux
gardiens en poste, il revit les moments les plus mémorables
de son existence d’artiste confronté à l’histoire
tumultueuse de la Chine du 20e siècle.
C’est
à la fois vrai, et trompeur : vrai pour ce qui concerne les
grandes lignes du scénario, trompeur car tout est dans les
détails, narratifs et esthétiques. « A New Old Play » est
une œuvre d’artiste à contre-courant du cinéma actuel, et
surtout du cinéma chinois, mais le présenter ainsi serait
encore réducteur, car « A New Old Play » est avant tout un
film éminemment personnel, de par sa conception même, mais
aussi par les choix et exigences esthétiques de sa
réalisation.
·
Une
histoire familiale
« A
New Old Play » est inspiré de l’histoire familiale du
réalisateur, et plus précisément celle de son grand-père,
Qiu Fuxin (邱福新),
célèbre acteur d’opéra
du Sichuan
(川剧),
décédé en 1987 alors que Qiu Jiongjiong avait dix ans.
Pour le 30e anniversaire de sa mort, en 2017, le
père du réalisateur a écrit une biographie du grand acteur,
et a demandé à Qiu Jiongjiong d’en illustrer les 15
chapitres – ce qu’il a fait, en l’espace de deux mois. Son
grand-père avait exercé une influence prédominante sur son
éducation et sa formation hors des sentiers battus
universitaires et institutionnels ; il apparaît en filigrane
dans son œuvre, à commencer par son deuxième court métrage,
« L’Ode à la joie » (《彩排记》),
c’est-à-dire « Répétitions ». C’était déjà un hommage à
l’art de Qiu Fuxin, réalisé en 2007, pour le 20e
anniversaire de la disparition du grand artiste, spécialiste
des rôles de chou (丑),
un rôle bien plus important dans l’opéra du Sichuan que dans
les autres opéras traditionnels chinois.
Qiu
Fuxin dans l’opéra du Sichuan « Deux collectes d’or »
《双拾黄金》
https://www.youtube.com/watch?v=mDnpephEhTQ
La vie
de la troupe familiale, baptisée Xin You Xin (“新又新”
), littéralement « Nouveau et encore nouveau », a longtemps
été l’environnement familial de Qiu Jiongjiong : sa
grand-mère maternelle Lin Zhigang (林志刚)
y a rencontré son mari – elle est le sujet du film de 2011
« My Mother’s Rhapsody » (《萱堂闲话录》)
– et le père du réalisateur, Qiu Zhimin (邱志敏),
était un restaurateur, et un conteur exceptionnel, qui est
le sujet du tout premier film de
Qiu Jiongjiong,
« Moon Palace » (《大酒楼》)…
et on le retrouve en chair et en os dans « A New Old Play ».
Qiu
Jiongjiong a vécu à Leshan, avec son grand-père, jusqu’à
l’âge de dix ans, et il a appris l’opéra avec lui.
| |

Qiu
Jiongjiong enfant apprenant l'opéra avec son
grand-père |
|
C’est
tout cet univers bordant le fantastique que Qiu Jiongjiong a
fait revivre dans son film, avec les moyens du bord,
pourrait-on dire : toutes les ressources de son art de
peintre et de son imagination de créateur au service d’un
art de la scène aussi minimal que celui de l’opéra chinois.
·
Un
film opératique
Le film
est né d’un projet initial intitulé « Neo-New Adventures »,
titre du scénario que Qiu Jiongjiong a écrit de mai 2017 à
février 2018, inspiré de l’appellation de la troupe de son
grand-père. Il était au départ non-fictionnel, fondé sur les
éléments biographiques de Qiu Fuxin. C’est en en faisant un
« objet » cinématographique que Qiu Jiongjiong en a fait une
fiction, extrêmement originale, en mêlant des inspirations
de tous horizons, théâtre et cinéma, explicitement
revendiquées, qui incluent aussi bien Fellini que Brecht et
Tati, dans un cadre qui est celui de l’opéra du Sichuan,
dans la langue originale, celle parlée à Leshan.
| |
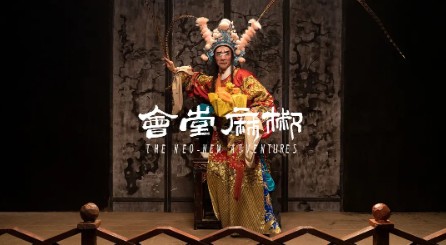
The Neo-New Adventures |
|
Le
scénario retrace donc l’histoire du personnage de Qiu Fu (丘福),
alter ego du grand-père, dont est souligné le rôle de
chou, ne serait-ce que par son maquillage (soulignant de
blanc la base du nez), donnant à l’ensemble un esprit
spécifique qui est celui de ces rôles dans l’opéra du
Sichuan. Le film se déroule en séquences successives comme
des actes dans un opéra, en partant de la séquence
initiale (Qiu Fu arrivé aux portes du monde des Enfers),
traitée sur un mode fantastique, mais opératique. Dès le
départ, toute notion de réalisme est exclue, ajoutant un
effet de distanciation entre scène et auditoire, comme chez
Brecht, et laissant au spectateur le soin de décrypter les
scènes par sa propre imagination, comme autrefois le
faisaient les spectateurs des représentations données par
les troupes d’opéra ambulant.
L’histoire se déroule en flashback à partir de cette
séquence initiale, des années 1920, de la chute de la
dernière dynastie à la période des seigneurs de la guerre,
aux années 1980, en passant par toutes les grandes phases de
l’histoire chinoise de cette moitié de siècle : guerre
sino-japonaise, guerre civile, fondation de la République
populaire, etc. Mais ce n’est qu’un cadre : ces événements
historiques ne sont évoqués qu’indirectement, par les
incidences qu’ils ont sur la vie de Qiu Fu et de son
entourage, et sur la vie de la troupe qui change
d’appellation avec les changements de régime.
| |

La
troupe, années 1920 |
|
Les
tableaux successifs récréent une atmosphère sans vouloir
être réalistes, comme le fait le théâtre. Chaque tableau
pourrait avoir un titre. Ainsi, la fin des Qing est évoquée
par une séquence qui pourrait être intitulée « l’ère de
l’opium », avec un côté typiquement « décadent », et un côté
caricature qui rejoint l’esprit « chou ».
| |

La
plaie de l’opium, « dans le passé » |
|
Les
tableaux suivants sont construits de la même manière, au gré
des péripéties historiques qui influent sur l’identité des
personnages. Le trait est souvent forcé, la satire d’une
ironie souvent cinglante. Si la Révolution culturelle
apparaît comme une mascarade et la Chine populaire comme un
régime incapable de construire des murs droits, la Grande
Famine est évoquée dans la pire de ses horreurs, mais sans
dramatisation excessive ; c’est peut-être l’une des seules
séquences où affleure un réalisme sans fard, à l’aune de cet
épisode sanglant de la période maoïste qui reste un tabou
intégral, que même les films les plus critiques, et
interdits, n’ont jamais osé aborder, et en particulier dans
des termes aussi crus et directs, même dans l’ironie, que
ceux du film de Qiu Jiongjiong.
On se
gardera bien d’en divulguer les détails, mais il faut saluer
ce véritable défi à la censure, qui empêche le film d’être
diffusé en Chine, sauf à le défigurer en supprimant
l’inacceptable ou considéré comme tel.
Cette
manière de concevoir le film va de pair avec sa mise en
œuvre, volontairement minimaliste, et pas seulement faute de
moyens : par impérative nécessité stylistique.
·
Un film « bouts de ficelle »
Le
film a été tourné en août 2019 à Leshan, la ville de Qiu
Jiongjiong et de son grand-père, dans la vieille usine d’un
ami où a été recréé un studio de fortune de 400 m2. C’était
aussi le site du tournage du film précédent, « Mr. Zhang
Believes » (《痴》),
dont le titre chinois signifie « fou à lier ». Ce film,
réalisé en 2015, préfigurait « A New Old Play » en tant que
cinéma documentaire expérimental faisant état d’une histoire
opposée à l’histoire officielle (celle des
camps de laogai),
dans une esthétique très stylisée, au niveau des couleurs
autant que de la conception générale : une sorte de théâtre
d’ombres. Pour ce film aussi une tente avait été construite
sur le parking de l’usine en guise de studio.
| |

A New Old Play, théâtre d’ombres |
|
Pour
« A New Old Play », Qiu Jiongjiong a repris l’idée de décors
fabriqués et peints à la main, dans des matériaux naturels,
bois, coton, tissu, pierre, briques, comme pour les
représentations théâtrales d’autrefois, avec une exagération
frisant l’absurde soulignant le fond du propos. Tout est
visiblement faux, dans une esthétique expressionniste, pour
induire un effet théâtral, avec l’effet de distanciation
propre à la dramaturgie de Brecht. Un bateau hébergeant la
troupe vogue sur une mer de tissu blanc agité à la main ; le
fleuve de l’oubli est un tissu gris ; la distinction entre
monde des vivants et monde des morts repose simplement sur
la lumière, plus ou moins diffuse, plus ou moins claire, et
sur la couleur des accessoires, noirs ou blancs.
L’esthétique évoque souvent Jacques Tati avec une semblable
maladresse voulue, savamment poétique.
| |

Décors de théâtre |
|
·
Un film familial
À cette esthétique théâtrale s’ajoutent la personnalité et
le jeu des acteurs et des membres de l’équipe qui sont tous
des parents, des proches ou des amis du réalisateur, comme
les troupes de théâtre autrefois. Les acteurs sont non
professionnels contrairement aux membres de la troupe qui
sont des acteurs d’opéra du Sichuan.
- Le
personnage principal de Qiu Fu (丘福)
adulte est interprété par Yi Sicheng (易思成),
un curateur de festivals de cinéma que Qiu Jiongjiong a
rencontré au festival Yunfest et qui jouait un rôle mineur
dans « Mr. Zhang Believes ».
-
L’épouse de Qiu Fu, Tong Huafeng (桐花凤),
est interprétée par Guan Nan (关南)
et le double rôle du fils adolescent de Qiu Fu et de
« Pattes de poulet » (鸡脚神),
le cuisinier de l’auberge du Bossu, est joué par Xue Xuchun
(薛旭春),
tous deux spécialistes de l’organisation de festivals de
cinéma, proches du réalisateur et du producteur Ding
Ningyuan (丁宁远).
| |

Yi
Sicheng et Guan Nan |
|
-
Gu Tao (顾桃),
qui interprète le rôle du Bossu (Tuó’er
驼儿),
serviteur de la troupe et ultérieurement aubergiste dans
l’au-delà, est un documentariste indépendant ; son rôle a
été tout spécialement conçu comme aphasique car Qiu
Jiongjiong avait peur qu’il n’arrive pas à mémoriser son
texte ; du coup il a imaginé un effet supplémentaire en
ajoutant un surtitrage, comme dans les films muets des
débuts du cinéma, mais un surtitrage très esthétique lui
aussi.
| |

Retrouvailles sur le pont des enfers, avec
surtitrage (à g.) |
|
-
Qiu Zhimin (邱志敏)
interprète le rôle de Liu Anren (刘安仁),
dit le Vérolé (Ma’er
麻儿),
fondateur de la troupe de théâtre Nouveau-Nouveau
(personnage inspiré du seigneur de la guerre passionné
d’opéra Ma’er chez lequel Qiu Xinfu s’est réfugié pendant la
guerre) : c’est le père du réalisateur.
-
Chen Haoyu (陈浩宇),
Qiu Fu enfant, est un neveu. Il est étonnant de vie et
d’entrain, et il ressemble en outre aux autoportraits au
même âge peints par Qiu Jiongjiong.
|

Chen Haoyu (Qiu Fu enfant) |

Autoportrait de Qiu Jiongjiong |
|
- La
musique du film est signée par un proche qui s’est
étroitement inspiré de thèmes de l’opéra du Sichuan. Quant à
Qiu Jiongjiong, il fait une apparition cameo à la fin du
film, comme un clin d’œil, au moment où la troupe fait la
queue pour aller boire la potion de l’oubli, avant de passer
le fleuve et quitter le monde des morts. Il se pose ainsi
comme un descendant de l’histoire familiale et de la lignée
des chou.
·
Chronique historique et culturelle
Ces
éléments personnels parachèvent la maîtrise formelle d’un
film où rien n’a été laissé au hasard, y compris les
dialogues en dialecte de Leshan qui ajoutent leur propre
musique à l’ensemble. De cette formidable fresque émergent
quelques grands thèmes à la fois historiques et culturels,
mais traités pour leur incidence sur la vie de chacun.
-
Chronique historique, de la chute des Qing à la fin de
la Révolution culturelle, en passant par la période des
Seigneurs de la guerre, la guerre sino-japonaise, la guerre
civile, la fondation de la République populaire, la Grande
Famine et la Révolution culturelle.
Le
thème général est que l’Histoire se répète sans cesse, mais
le film tend à montrer un contraste entre le destin
individuel, porté par des personnalités vivantes et
dynamiques, et le sort cruel et implacable que leur réserve
l’Histoire. La narration met en relief les histoires
individuelles, loin de l’idéologie et des phrases
abstraites. L’impact en est d’autant plus fort. C’est le cas
en particulier de la séquence sur la Grande Famine, contée
sous l’angle très personnel d’un bébé abandonné, évidemment
une petite fille, recueillie par Qiu Fu et nourrie, à grand
peine, par sa femme, dont le sort est expliqué par la mère
qui revient la chercher : toute la tragédie, et l’horreur,
de la période est dite en quelques mots.
L’Histoire est évoquée à travers les souvenirs personnels,
individuels et familiaux, cette « mémoire populaire » dont a
parlé Michel Foucault en 1974, dans un entretien accordé aux
Cahiers du cinéma, en désignant ainsi la mémoire de
ceux qui n’ont pas les moyens de l’écrire eux-mêmes et de la
diffuser.
Mémoire personnelle devenue « devoir de mémoire ».
Devoir évoqué de manière subliminale à la fin du film quand
les membres de la troupe de théâtre, dont Qiu Jiongjiong,
font la queue pour boire la potion de l’oubli (迷魂汤)
de Meng Po (孟婆),
avant de quitter le monde des morts.
C’est
une nouvelle perspective pour aborder l’Histoire dans son
aspect quotidien, qui inclut l’humour, même là où on
l’attendrait le moins, et par exemple, encore, dans la
séquence de la Grande Famine. Il y a un jeu à la fois sur le
concret et sur la métaphore, un détail particulier prenant
un sens symbolique, en particulier grâce à l’esthétique
minimaliste du film.
| |

Souvenirs du monde des morts |
|
- La
culture du Sichuan est le cadre et l’objet
de cette saga familiale contée comme un opéra,
opéra du Sichuan dont le langage est réinventé et modulé. Le
film y gagne une dimension d’œuvre classique, mais enracinée
dans la culture populaire locale, et rendue de manière très
vivante par l’utilisation du dialecte de Leshan. On peut le
comparer à la création d’une tradition d’anglais
vernaculaire par Chaucer, mais qui prend un sens tout
particulier dans la Chine d’aujourd’hui où l’on voit les
dialectes prendre une place croissante tant en littérature
qu’au cinéma, en remettant en valeur les cultures locales.
- Liée
à cette culture est la vision de la mort des Sichuanais, qui
prend des formes plus souples que globalement dans la
tradition chinoise, en cherchant à établir une harmonie
entre tristesse et joie. Le film tout entier est en fait le
processus par lequel Qiu Fu se prépare à passer le pont
Naihe (奈何桥)
et quitter la « ville des morts » (Fengdu
丰都城),
en se remémorant une dernière fois les événements de sa vie
passée.
On est
plongé dès la première séquence dans cette mythologie revue
et corrigée de manière humoristique : Qiu Fu est accueilli
par les deux gardiens de la porte des enfers que sont, selon
la tradition, « Tête de bœuf » (牛头)
et « Face de cheval » (马面),
qui sont chargés de l’emmener, à son corps défendant, devant
le roi des enfers, Yanluo Wang (阎罗王).
On
pense au « Septième
jour » (《第七天》)
de
Yu Hua (余华),
mais
un « Septième jour » qui serait adapté en opéra du Sichuan
par un dramaturge désargenté, mais inspiré. Et refusant les
sirènes de la censure en préférant renoncer à une sortie
nationale afin de préserver son œuvre dans son intégrité.
À
lire en complément
L’entretien
avec le producteur Ding Ningyuan
par dGenerate.
L’article (illustré) de
The Paper
(en chinois).
Interview par Shelly Kraicer.
|
|