|
Repères historiques : cinéma de Hong Kong
VIII. Années 2010-2020 : manifestations et loi de sécurité
nationale
par
Brigitte Duzan, 2 décembre 2023
Les
années 2010 commencent dans un contexte de tension
croissante. À partir de 2014, Hong Kong entre dans une
période de manifestations contre la progressive érosion des
libertés pourtant garanties par le pouvoir chinois au moment
de
la
Rétrocession.
Une
nouvelle génération de jeunes cinéastes s’engagent aux côtés
des manifestants pour réaliser des documentaires destinés à
fixer pour la postérité les luttes pour la préservation des
lois et des libertés qui perpétuent celles de leurs
prédécesseurs. C’est le cas en particulier de
Chan
Tze Woon (陈梓桓),
et de ses deux documentaires :
« Yellowing » (《乱世备忘》)
tourné caméra au poing dans les rues de Hong Kong lors des
manifestations de 2014, et
« Blue
Island »
(《忧郁之岛》)
qui en est la suite, sur les manifestations de 2019-2020,
jusqu’à l’adoption, le 30 juin 2020, de la loi de sécurité
nationale qui signale la reprise en main brutale de Hong
Kong par le pouvoir de Pékin.
2014 : le mouvement des parapluies jaunes
Les
manifestations
L’élection au suffrage universel du chef de l’exécutif de
Hong Kong avait été prévue par la loi à portée
constitutionnelle entrée en vigueur le jour de
la
rétrocession,
le 1er juillet 1997. Or, en août 2014, les
autorités chinoises ont annoncé que les candidats seraient
préalablement sélectionnés par un comité de 1 200
personnes ; mais en pratique il s’agirait uniquement de deux
ou trois « patriotes » faisant allégeance à la ligne
politique de Pékin. Cette annonce entraîne un mouvement de
désobéissance civile visant à paralyser le centre de Hong
Kong, d’où le nom du collectif : Occupy Central (佔領中環)
.
| |

La Révolution des
parapluies, manifestation de nuit le 10 octobre 2014 |
|
Le 10
septembre, le cardinal Zen, évêque émérite de Hong Kong,
signe un éditorial dans le journal Asia News incitant à
résister « pour ne pas devenir des esclaves ». Dans la
semaine du 22 septembre, des étudiants commencent à
manifester devant le siège du gouvernement. Dans la nuit du
26 septembre, les manifestants occupent les principales
artères de Hong Kong. La police arrête les leaders
étudiants, dont Joshua Wong et Alex Chow. Le 27 septembre,
la foule des manifestants investit Civic
Square. Une véritable marée humaine se répand dans les rues.
Le lendemain, la police tente de disperser la foule avec des
gaz lacrymogènes. Cela ne fait que renforcer le mouvement
qui va occuper les artères principales pendant près de six
semaines.
Fin
septembre, ces manifestations ont pris le nom de
« révolution des parapluies » (雨傘革命)
en raison de l’utilisation de parapluies par les
manifestants pour se protéger des gaz lacrymogènes –
parapluies jaunes devenus symbole du mouvement. Le 2
octobre, les manifestants exigent la démission du chef de
l’exécutif de Hong Kong, Leung Chun-ying, soutenu par la
Chine. Le lendemain, les triades interviennent avec violence
contre les manifestants dans le quartier de Mong-Kok. Mais
les manifestations se poursuivent.
Le
projet de loi est finalement rejeté le 18 juin 2015 par le
Conseil de Hong Kong. Mais il a érodé la confiance de la
population.
Jusque-là, tout le monde à Hong Kong croyait en la
constitution, croyait que les lois et les libertés
fondamentales pourraient être préservées. À partir de 2014,
tout a changé : Pékin montrait clairement qu’il se souciait
comme d’une guigne des textes que lui-même avait signés. Les
Hongkongais ont dès lors cherché des moyens plus radicaux de
lutter pour la démocratie. Les documentaires sur la
situation se sont multipliés. C’est un tournant dans le
travail des jeunes cinéastes : leurs films deviennent un
engagement direct.
Les
films
Le
film qui a le plus de succès à Hong Kong à la suite de ces
manifestations est un film
d’anticipation sorti en 2015 : « Ten
Years » (《十年》).
Traduisant l’état d’esprit de la population de Hong Kong
face à l’érosion progressive de ses libertés et de ses
droits, le film a battu des records d’audience, battant même
le dernier « Star Wars » au box-office et couronné meilleur
film aux 35e Hong Kong Film Awards en avril 2016.
Constitué de cinq courts métrages de cinq jeunes
réalisateurs, « Ten Years »
envisage la lente érosion des libertés à Hong Kong
dans les dix années à venir, y compris la progressive
imposition du mandarin dans la vie quotidienne aux dépens du
cantonais.
| |
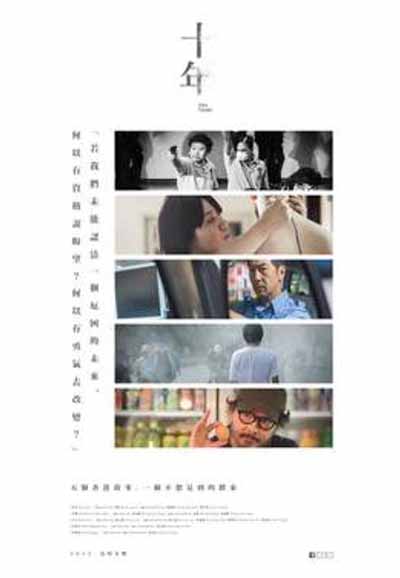
Dix ans, affiche
officielle |
|
Le
prix décerné aux Hong Kong Film Awards a déclenché une
réaction violente des autorités chinoises ; le Global Times
– porte-parole du Parti communiste – l’a qualifié de « virus
pour l’esprit » et « Ten Years » a disparu des écrans.
Révélant la persistance de la combattivité de la population,
et des jeunes en particulier, il a entraîné en outre un
raidissement des contrôles de censure dont a également pâti
« Yellowing » qui, sorti sur ces entrefaites, n’a pas trouvé
de cinéma désireux de l’accueillir. Les deux films ont été
projetés dans des lieux publics grâce à divers groupes et
institutions, dont les églises, mais interdits à la
télévision ou sur internet.
Les manifestations de 2019-2020
Les
manifestation de 2014 peuvent être considérées comme une
sorte de répétition générale de celles qui vont se dérouler
en 2019 et durer jusqu’à l’imposition de la loi de sécurité
nationale par le gouvernement de Pékin le 30 juin 2020, loi
qui met fin au régime de semi-liberté dont jouissait Hong
Kong depuis la Rétrocession.
Manifestations massives
Les
manifestations sont déclenchées par l’introduction en
février 2019 d’un amendement à la loi d’extradition qui
mettait en danger l’indépendance du système juridique de
Hong Kong, garanti par Pékin lors de la
rétrocession en 1997,
en menaçant la sécurité personnelle des habitants aussi bien
que des étrangers. Le ressentiment contre le gouvernement
chinois et la méfiance envers ses méthodes répressives s’est
accru dans les années 2010 après l’échec relatif des
manifestations de 2014, l’affaire des « libraires disparus »
en 2016, la destitution la même année par Pékin de six
députés d’opposition qui venaient de prêter serment et
l’emprisonnement de plusieurs militants prodémocratie en
2017. Les empiètements progressifs du régime de Pékin sur
les libertés locales, dans le domaine de la langue et de la
culture en particulier, n’ont fait qu’exacerber une crise
identitaire latente, surtout chez les jeunes touchés en
outre par la précarité croissante des conditions de vie et
de travail.
Les
manifestations de 2014 ont contribué à créer une nouvelle
génération d’activistes nourrie des leçons du passé. Les
premières manifestations après l’introduction du projet
d’amendement en février 2019 sont suivies le 15 mars d’un
sit-in devant le gouvernement central. Neuf personnes sont
arrêtées par la police. Le 31 mars, une première
manifestation est organisée par le Front civil des droits de
l’homme, suivie d’une deuxième, de plus de quatre heures, le
28 avril, la plus importante depuis 2014. La cheffe de
l’exécutif Carrie Lam (qui a succédé à Leung Chun-ying le 1er
juillet 2017) ne cède pas. Le 6 juin, plus de 3 000 avocats
participent à une marche silencieuse, vêtus de noir,
derrière le conseiller législatif Dennis Kwok.
Le 9
juin, une troisième manifestation est organisée par le Front
civil : c’est la plus importante depuis la Rétrocession,
avec plus d’un million de participants – participation
massive reconnue par le gouvernement de Hong Kong le soir,
mais sans modifier la deuxième lecture prévue du projet
d’amendement. Des manifestants en colère décident d’occuper
le conseil législatif pour tenter de l’empêcher, entraînant
une intervention musclée de la police. La plupart des
manifestants sont des jeunes (de moins de 25 ans).
Le 12
juin, plus de 400 entreprises appellent à la grève. Une
manifestation a lieu au parc Tamar dans la nuit ; au matin
du 13 juin, les manifestants bloquent les rues autour du
conseil législatif pour empêcher les conseillers d’y
entrer ; certains tentent d’occuper le bâtiment. La police
réplique avec gaz lacrymogène, gaz poivre, balles en
caoutchouc, etc. et procède à des arrestations. Le soir du
13, 4 étudiants sont appréhendés à l’Université de Hong
Kong.
| |

Occupation des rues autour du Conseil législatif le
13 juin 2019 |
|
Le 14
juin, lors d’une conférence de presse, Carrie Lam se
présente comme mère des Hongkongais, provoquant un
rassemblement des « mères hongkongaises ». Le 15 juin, elle
annonce que le projet d’amendement était suspendu, mais non
retiré, d’où une quatrième manifestation organisée par le
Front civil : plus de deux millions de participants, avec un
taux de participation supérieur à celui de 1989 en
solidarité avec les manifestations de la place Tian’anmen.
La manifestation se poursuivant, le complexe gouvernemental
est obligé de fermer le 17 juin, jusqu’au lendemain.
Le
gouvernement ne répondant pas aux demandes, une autre
manifestation a lieu le 21 juin, ciblant le quartier général
de la police et les édifices gouvernementaux, suivie
d’autres jusqu’au 1er juillet et le défilé de
commémoration du 22ème anniversaire de la
rétrocession, avec pour thème : « Non à l’amendement de la
loi d’extradition, départ immédiat de Carrie Lam » (撤回惡法
林鄭下台).
Mais les débats se poursuivent pendant ce temps au conseil
législatif, entraînant des rassemblements de protestation
devant les bâtiments, puis un véritable siège, une tentative
de pénétrer dans le complexe en brisant les vitres, et
l’occupation temporaire de l’hémicycle. Des manifestations
se poursuivent pendant les mois de juillet, août et même
septembre, culminant le 30 août avec l’arrestation des
militants pro-démocrates Joshua Wong et Agnes Chow, lui dans
la rue, elle à son domicile.
On est
en pleine épidémie de covid-19. Or, début octobre, Carrie
Lam décrète l’interdiction du port du masque lors des
manifestations, interdiction déclarée anticonstitutionnelle
fin octobre par la Haute Cour de Hong Kong. Le mouvement se
poursuit, avec un durcissement des violences. Plusieurs
universités et établissements scolaires ferment. Le 15
novembre, le campus de l’Université chinoise de Hong Kong
est évacué. Les étudiants se retranchent dans l’Université
polytechnique ; les affrontements sont violents, les
protestataires dressent des barricades, l’université se
transforme en camp retranché.
Le 24
novembre ont lieu des élections locales qui se terminent par
une large victoire des pro-démocrates avec un taux de
participation élevé, après quoi les manifestants réitèrent
leurs revendications, dont l’instauration du suffrage
universel. Carrie Lam refuse toujours toute concession et
les médias chinois mettent en question la légitimité du
scrutin, pour cause de manœuvres d’intimidation. En
décembre, les manifestations reprennent.
C’est
finalement la pandémie de covid-19 qui a permis,
indirectement, au gouvernement chinois de reprendre la
situation en main.
La
loi sur la Sécurité nationale
Le 30
juin, après un processus d’examen accéléré, le Comité
permanent de l’Assemblée nationale populaire chinoise adopte
la Loi sur la Sécurité nationale – littéralement « Loi de la
République populaire de Chine sur la sauvegarde de la
sécurité nationale dans la région administrative de Hong
Kong » (中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法)
– loi qui doit ensuite être incorporée à la Loi fondamentale
de Hong Kong. Cette loi est promulguée par le Comité
permanent de l’ANP au lieu du Conseil législatif de Hong
Kong qui aurait dû le faire selon les termes de la Loi
fondamentale de Hong Kong. Le caractère de plus en plus
restrictif de la législation sur la sécurité nationale en
Chine, appliquée à partir de 1993, est très net depuis
l’instauration par le président Xi Jinping, peu après son
arrivée au pouvoir, d’une commission de sécurité nationale
qu’il dirige en personne et vise à écraser la dissidence.
L’adoption de la loi provoque un choc. Elle montre la
volonté de Pékin de mettre fin au statut privilégié dont
bénéficiait Hong Kong selon les termes de la Rétrocession,
et à la liberté, même relative, dont jouissaient ainsi les
Hongkongais.
Une
manifestation est organisée le 1er juillet, jour
d’entrée en vigueur de la loi : 300 manifestants sont
arrêtés. Les arrestations se poursuivent par la suite, tout
rassemblement pouvant être considéré comme mettant en danger
la sécurité nationale, y compris les manifestations
pacifiques sur les campus universitaires. Ainsi, le 17
novembre, lors d’une manifestation d’une centaine de
personnes sur le campus de l’Université chinoise de Hong
Kong, la police intervient et arrête huit personnes, dont
trois étudiants.
Début
2021, non seulement des activistes prodémocratie mais aussi
pro-LGBT sont accusés de subversion et arrêtés. En juillet
2021, c’est au tour des médias d’être visés sous couvert de
« fake news » et de désinformation.
Les
Hongkongais répliquent en émigrant, comme le suggèrent en
demi-teinte les textes de
Leung
Lee-chi (梁莉姿)
intitulés « Pièces vides » (《空室》)
,
présentés ainsi par l’auteure dans sa note introductive :
1968年,劉以鬯寫下《動亂》,以十四件死物視角切入,書寫六七暴動中的紛亂現場,各死物間,似乎多是無措無知,對動亂緣由一無所知;2020年年末,威權時代逼近,我寫下《空室》回應原作。願所有離開的人都記得一切背負,是為記。
En
1968, Liu Yichang a écrit « Troubles », une série de textes
dans lesquels il évoque le chaos des émeutes de 1967en se
plaçant du point de vue de quatorze objets inanimés, tous
dans le plus grand désarroi car incapables de comprendre les
causes des désordres
;
à la fin de 2020, voyant approcher une ère d’autoritarisme,
j’ai écrit « Pièces vides » en écho à l’œuvre originale de
Liu Yichang. J’espère rappeler ainsi ce que nous avons subi
à tous ceux et celles qui seront amené.es à partir, afin que
ce ne soit pas oublié.
C’est
cette même volonté de relier les manifestations de 2019-2020
aux luttes antérieures, en remontant jusqu’aux émeutes de
1967, qui constitue le fil directeur du scénario du film de
Chan
Tze Woon (陈梓桓),
« Blue Island
»
(《忧郁之岛》),
entre documentaire et fiction.
|