| |
« Walker » de Tsai Ming-liang : éloge de la lenteur
par Brigitte Duzan, 09 juin
2012
|
« Walker » (《行者》)
est un court métrage de
Tsai Ming-liang (蔡明亮)
qui a été présenté en clôture de la Semaine de la Critique
au festival de Cannes, le 24 mai 2012.
C’est aussi l’un
des films de la série intitulée
« Beautiful
2012 » (“美好2012”),
initiée par le site de cinéma en ligne youku (优酷),
et produite par la société de production du festival de Hong
Kong. Il est en accès libre sur youku depuis la fin
du mois de mars, et a suscité un grand intérêt : plus de dix
mille commentaires le premier mois, la plupart pour
critiquer l’a priori de lenteur du réalisateur, ou au
contraire le louer.
Ce
n’est cependant qu’un aspect d’un film qui est en fait une
pause dans la trépidation de la
|
|
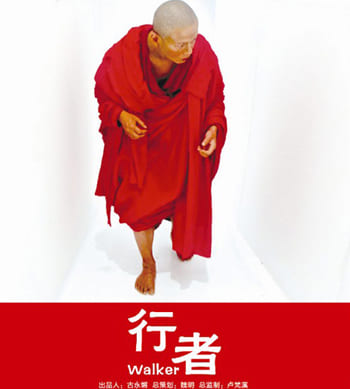
Walker |
vie moderne dans une grande
ville, et une réflexion à la faveur de cette pause.
Réflexion incarnée
La première
séquence nous laisse apercevoir, dans le mince espace d’un
couloir donnant sur une rue, un homme de dos, vêtu d’une
longue robe rouge, qui descend les quelques marches qui le
séparent encore du trottoir devant lui. Il progresse à la
vitesse d’un lémurien, chaque pas semblant le résultat d’un
effort laborieusement concerté.
La séquence
suivante le montre dans la rue, quelques infinis instants
plus tard, poursuivant son avance infinitésimale, la tête
penchée vers le sol, comme pour mieux concentrer son
attention sur le pied provisoirement tendu, amorçant un
mouvement savamment décomposé. C’est une volonté d’extrême
concentration qui conditionne le détachement.
Il y a ainsi
dix-neuf séquences au total, qui font vingt avec le
générique final : comme une série de scènes le long d’un
chemin de croix, avec ce point rouge impavide au milieu de
la foule, des voitures, des bus et des trams.
On dirait un saint
portant des emblèmes dérisoires : un sac de plastique d’une
main, un beignet de l’autre, dans lequel il va croquer au
bout de vingt cinq minutes, avec la même lenteur calculée.
On dirait un moine,
bien sûr, robe rouge et crâne rasé, mais la robe a des plis
superbes, savamment drapés, de statue sulpicienne : c’est
bien plus un fruit de l’imagination de Tsai Ming-liang, une
figure emblématique émanant de sa réflexion, mais aussi de
son cinéma, les deux ne faisant plus qu’un, sous les traits
de son double et fétiche, Lee Kang-sheng.
Beauté
dans la lenteur
Cette lenteur
calculée, mesurée, comme immanente, finit par exercer un
véritable pouvoir de fascination ; on se sent gagné par le
sentiment d’absolue nécessité du geste du marcheur, et l’on
comprend que Tsai Ming-liang a gagné son pari, l’excès même
de lenteur attirant l’attention sur la rareté qu’elle est
devenue dans notre monde urbain, rareté à préserver
précieusement comme on conserve des reliques.
|

Dernière séquence,
gros plan |
|
Ce n’est pas, a
commenté le réalisateur, que le film est trop lent, c’est
que nous avons pris l’habitude d’aller trop vite. Ce n’est
pas qu’il est ennuyeux, c’est que nous sommes habitués à
être éblouis par la fulgurance d’images trop rapides ; elles
nous entraînent et nous nous laissons conduire sans
réfléchir. Il y a donc un problème de rythme à reconsidérer.
|
C’est Hong Kong qui
est le cadre urbain de référence, avec deux sites aisément
identifiables : Mong Kok, à
Kowloon, et Causeway Bay, zone sans doute la plus
grouillante de Hong Kong, où l’homme devient centre
d’attention de regards étonnés, mais à peine. La ville est
prise dans une dimension symbolique, mais pas seulement :
tout habitant peut s’y reconnaître.
Hommage à Hong Kong
Le film est un
hommage à Hong Kong, avec un clin d’œil à son cinéma
populaire, omniprésent avec la publicité géante en pleine
rue du film « Le prince au cheval noir » (《黑马王子》)
et son interprète principal et symbolique, Andy Lau (刘德华).
Les rues mêmes deviennent décor.
Le film se termine
d’ailleurs par un autre clin d’œil : la chanson qui
accompagne le générique final, à laquelle personne n’a
semblé prêter grande attention, mais qui donne en fait un
cadre et une ouverture inattendue à la réflexion du
réalisateur. C’est une chanson cantonaise de 1974, d’un
acteur et chanteur légendaire, la star du cantopop Sam Hui (许冠杰).
Elle s’intitule
« Une rivière coupe l’horizon » (《
一水隔天涯》),
et c’était à l’origine une chanson pleine d’humour disant
que l’argent est roi, que sans argent pas d’amour, etc… Les
paroles du film sont légèrement différentes :
Si une rivière divise le pays en deux,
ceux qui n’ont rien sont du côté des malheureux,
Sans richesse, tout n’est que songe…
Le bonheur ne va pas avec la faim…
Ceux qui ont la richesse sont du côté des gens heureux.
Le long de la rivière qui divise le pays,
C’est à toi de voir de quel côté tu veux être.
Du coup, le film
prend une signification plus profonde, que Tsai Ming-liang a
glissée ainsi in extremis, en souriant…
Le film sur
youku
|
|