| |
Cheng
Bugao
程步高
1898-1966
Présentation
par Brigitte Duzan, 22
novembre 2011
|
Cheng Bugao
(程步高)
est né en
1898 à Pinghu, district de la ville de Jiaxing, dans
le Zhejiang (浙江嘉兴平湖人).
Il fait
partie de la première génération des réalisateurs
chinois qui, dans des conditions matérielles
difficiles, ont créé ex nihilo une cinématographie
riche et originale et nous ont laissé les chefs
d’œuvre des deux « âges d’or » du cinéma chinois.
Cinéaste
par vocation : de la théorie à la pratique
Cheng Bugao
a d’abord étudié dans des écoles privées, avant
d’être admis à l’université jésuite l’Aurore (震旦大学),
à Shanghai, pour étudier le journalisme. C’est
pendant qu’il y était étudiant qu’il a commencé à
s’intéresser au cinéma, en écrivant des critiques de
films pour le supplément d’un |
|

Cheng Bugao jeune |
journal
progressiste de l’époque, à Shanghai, le Nouveau journal de
l’actualité (《时事新报》副刊) ;
il traduit aussi des articles de journaux occidentaux
traitant des nouvelles techniques cinématographiques. Il
acquiert ainsi une première formation toute théorique.
|
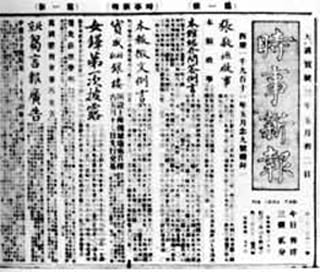
Le Nouveau journal de
l’actualité |
|
Il quitte
l’université sans obtenir son diplôme et retourne
dans son Pinghu natal enseigner à l’école primaire
jusqu’en 1922. Il revient alors à Shanghai dans
l’intention de faire carrière dans le cinéma.
D’après ses mémoires, c’est la faible qualité des
films chinois de l’époque qui l’aurait incité à se
lancer dans l’aventure. Après avoir rassemblé le
financement nécessaire, il crée un nouveau studio,
la compagnie Dalu (大陆影片公司).
Cheng Bugao
y fait ses débuts de réalisateur deux ans plus tard,
en 1924, avec le chef opérateur (et réalisateur)
Zhang Weitao (张伟涛),
l’auteur de |
la photographie du
film qui ‘sauva’ la Mingxing en 1923, « L’orphelin sauve son
grand’père » (《孤儿救祖记》) (1). Il tourne alors deux
documentaires et un premier film de fiction, intitulé « Malheureux
canards mandarins » (《水火鸳鸯》shuǐhuǒ
yuānyāng),
dans le but de les utiliser ensuite comme référence pour
tenter d’entrer dans un studio plus important.
|
Le premier
documentaire, « Wu Peifu » (《吴佩孚》),
était un portrait de Wu Peifu, le « maréchal de
jade » (玉帥)
de la Clique du Zhili, grand stratège, personnage
cultivé, calligraphe et peintre à ses heures, mais
impitoyable, qui, en 1923, avait cassé une grève du
chemin de fer Hankou-Pékin en envoyant des troupes
pour éliminer les grévistes, tuant trente-cinq
ouvriers et en blessant beaucoup plus. L’autre
documentaire, intitulé « Paysage de Luoyang »
(《洛阳风景》), est l’un des premiers
films chinois dits ‘de paysage’
(风景片).
A la Dalu encore,
Cheng Bugao
écrit le scénario d’un film tourné par un
autre réalisateur, Liu Guangming (刘兆明),
et sorti en janvier 1926 : « La jeune paysanne »
(《乡姑娘》).
Il réalise
ensuite quelques films dans des genres populaires
|
|

Wu Peifu vers 1925 |
lancés l’année
précédente par la nouvelle compagnie Tianyi (天一影片公司)
(1) : « Une femme vertueuse » (《空门贤媳》),
scénario adapté en 1926 d’une histoire popularisée par un
opéra huáijù (淮剧)
de la région de Shanghai/Huai’an, et un film d’arts martiaux
sorti début 1928, « L’héroïne à l’épée volante »
(《飞剑女侠》).
1928 : entrée à la
Mingxing
C’est grâce à
l’expérience ainsi acquise qu’il parvient, en 1928, à entrer
dans le plus grand studio de l’époque à Shanghai, la
compagnie Mingxing (明星影片公司),
où il trouve les moyens qui vont lui permettre de réaliser
une quarantaine de films en une dizaine d’années (dont plus
de vingt dans les quatre premières), jusqu’à l’occupation de
Shanghai par les Japonais fin 1937.
Il y travaille avec
les grands scénaristes de l’époque, en particulier Tian Han
(田汉),
Hong Shen (洪深)
et
Xia Yan (夏衍),
aussi bons scénaristes que dramaturges.
Ses trois premiers
films à la Mingxing témoignent de son intérêt, partagé avec
ses amis scénaristes, pour les thèmes sociaux capables de
toucher un vaste public, et ce avant même la naissance du
mouvement du cinéma de gauche.
En 1928, il écrit d’abord le scénario de « Divorce »
(《离婚》),
réalisé par le fondateur et directeur de la Mingxing, Zhang
Shichuan (张石川),
puis tourne deux films sur la vie des classes aisées. En
1931, il réalise son dernier film muet, comme « Divorce » un
mélodrame sur la misère de la condition féminine : « Pas de
chance de naître femme » (《不幸生为女儿身》).
Cheng Bugao est
alors à l’avant-garde des techniques du cinéma sonore à ses
débuts, censé redonner du tonus à un marché
cinématographique au bord de la crise, en raison de la
censure qui interdit les films d’arts martiaux mais aussi de
l’évolution des goûts du public. Il est en particulier l’un
des premiers réalisateurs chinois à avoir utilisé la
technique d’enregistrement du son sur disques de cire pour
la sonorisation des premiers films (蜡盘配音到胶片录音).
Il est l’assistant de Zhang Shichuan lorsque celui-ci tourne
le premier film sonore chinois, sur un scénario de
Hong Shen, « La
chanteuse Pivoine rouge » (《歌女红牡丹》),
sorti en 1931.
Au début de 1932,
au moment de l’attaque japonaise sur Shanghai, encore
appelée « première bataille de Shanghai » (2), il va sur le
front avec un photographe et en rapporte un documentaire
intitulé « La bataille de Shanghai » (《上海之战》).
En février 1933,
marque de sa place dans la profession, il devient membre de
l’Association pour la culture cinématographique nouvellement
créée (中国电影文化协会),
emblème et moteur d’un cinéma chinois "émergent" ("新兴电影").
Même s’il
n’en fait pas nommément partie, Cheng Bugao se range alors
dans un
cinéma "de gauche",
influencé par les idées communistes diffusées par les
scénaristes, mais aussi par le réalisme révolutionnaire du
cinéma soviétique, un cinéma orienté en outre par le désir
de promouvoir l’union nationale contre l’envahisseur
japonais.
C’est dans ce
cadre que, entre 1933 et 1937, il tourne ses meilleurs
films, et les plus célèbres, tous grands classiques de la
période.
1933-1937 :
Les grands classiques
Il réalise en
moyenne deux films par an pendant cette période, dont six
figurent parmi les plus célèbres.
|
- En 1933,
« Le torrent sauvage » (《狂流》)
et « Les vers à soie du printemps » (《春蚕》)
sont tous deux sur un scénario de Xia Yan (夏衍),
le second adapté de la nouvelle éponyme de Mao Dun (茅盾).
« Les vers à soie du printemps »
est sans doute le plus
célèbre : Mao Dun venait juste de publier sa
nouvelle, et c’est la première tentative en Chine de
porter une œuvre littéraire contemporaine à l’écran.
Le scénario reprend l’analyse de la situation des
petits |
|

Les vers à soie du
printemps |
producteurs de soie de la région du
Bas Yangzi ruinés par la crise internationale, la
concurrence qui lamine les prix et les conséquences de la
guerre.
|

Torrent sauvage |
|
Tourné au rythme de l’éclosion
des vers à soie, le film a un côté documentaire un
rien didactique. Mais surtout, Cheng Bugao y réalise
des innovations techniques inspirées des mouvements
de caméra qu’il avait admirés dans « L’aurore » de
Murnau : il fit glisser le trépied de la caméra sur
le plancher pour suivre l’action au plus près, sans
être limité par les rails.
C’est cependant « Le
torrent sauvage »
qui fit le plus de bruit à sa sortie, et c’est ce
film qui marqua véritablement le début du
mouvement du cinéma de gauche.
Il est d’autant plus |
|
intéressant qu’il a sa source dans un documentaire, et mêle,
bien avant Jia Zhangke et ses émules, le réel du
documentaire et l’imaginaire de la fiction.
L’histoire se passe en mai
1931 : une crue catastrophique du Yangzi partie de
la région de Wuhan a inondé seize provinces. Cheng
Bugao
est allé filmer un
documentaire avec deux cameramen ; il montre un
contraste saisissant entre les victimes qui se
battent pour survivre et les riches nantis qui
contemplent la scène de leur balcon. A son retour,
Xia Yan s’empare du documentaire et, sous le choc
des images, conçoit un scénario qui les transcrit en
les mêlant à la fiction qu’il imagine.
Cheng Bugao a ensuite
visualisé ce scénario pour faire ressortir le
conflit social entre pauvres anéantis par
l’inondation et familles aisées se livrant à leurs
loisirs habituels, l’alternance entre scènes de
fiction et |
|

Torrent sauvage :
scènes du film |
|

Le grand chef
opérateur Don Keyi |
|
séquences documentaires
estompant la limite entre réalité et fiction. La
qualité de l’interprétation, avec en particulier Hu
Die dans le rôle féminin principal, contribua à
renforcer l’impact du film sur le public. C’est
aussi un film qui révéla le plus grand chef
opérateur de l’époque : Dong Keyi (董克毅).
Le résultat fut une première,
le 5 mars 1933,
particulièrement agitée et une réaction immédiate du
gouvernement établissant des listes noires de films
interdits, suscitant des raids de ses « Chemises
bleues » sur les studios suspects, et procédant à
des arrestations.
En 1934, les thèmes choisis
par Cheng Bugao sont donc plus « consensuels » : la
mise en valeur du territoire et la lutte contre
l’envahisseur, donnant « Allons
au
Nord-Ouest »
(《到西北去》)
sur un scénario de Zheng Boqi (郑伯奇)
et « L’ennemi
commun »
(《同仇》),
à nouveau sur un |
scénario de Xia Yan, ainsi qu’un
sketch du film « Un classique pour les femmes » (《女儿经》).
|
En 1936, « La
petite Lingzi »
(《小玲子》),
sur un scénario de Ouyang Yuqian (欧阳予倩),
ainsi que
« Shanghai
d’hier et d’aujourd’hui »
(《新旧上海》),
sur un scénario de
Hong Shen (洪深),
reviennent
à des thèmes sociaux, mais sur un ton suffisamment
neutre pour ne pas susciter de controverse.
Pendant la
guerre, ensuite, Cheng Bugao rejoint Wuhan où il
réalise des courts métrages pour le divertissement
des soldats. |
|

L’ennemi commun |
Après la guerre :
cinéaste à Hong Kong
|

Cheng Bugao à la fin
de sa vie,
à Hong Kong |
|
Après la
guerre, en 1947, il part à Hong Kong où, de 1949 à
1961, il réalise plus d’une vingtaine de films pour
le studio Yonghua (永华影片公司)
et, à partir de 1952, le studio Changcheng (长城影片公司), le studio de Shanghai qui a été transféré à Hong Kong.
Les plus
célèbres de la période sont sans doute « Une joyeuse
réunion » (《欢喜冤家》),
en 1954, comédie familiale typique du cinéma de Hong
Kong de l’époque, « Ming Feng » (《鸣凤》),
en 1957, adapté du roman de Ba Jin (巴金) « Famille »
(《家》),
ou encore « La nature du printemps » (《有女怀春》),
en 1958, sur un scénario de ... Louis Cha (金庸). On est loin du cinéma de gauche et de l’atmosphère qui règne sur le
continent, où, au même moment, est lancé le Grand
Bond en avant !
Il se
retire du cinéma après un dernier film, en 1961,
passant les années qui lui restent à vivre à écrire
ses |
|
mémoires :
« Souvenirs du monde du cinéma » (《影坛忆旧》).
Elles ont été publiées à titre posthume en 1983 aux
Editions du cinéma, à Pékin (中国电影出版社),
et un fac-simile de l’édition originale a récemment
été réédité.
Cheng Bugao
est décédé à Hong Kong le 20 juin 1966, en laissant
au total une soixantaine de films à la postérité.
Notes
(1) Voir
Repères historiques
(1920-1930)
(2) Ce que
les Chinois appellent « l’incident du 28
janvier » et qui représente la première tentative
japonaise d’annexer Shanghai, à un moment où les
Japonais avaient déjà établi le Manchoukouo et
tentaient d’élargir leur mainmise sur le territoire
chinois. Le prétexte à l’ « incident » fut l’attaque
de cinq moines japonais d’une secte nationaliste, le
18 janvier, dont un mourut de ses blessures. Les
combats durèrent jusqu’au 3 mars, le cessez- |
|
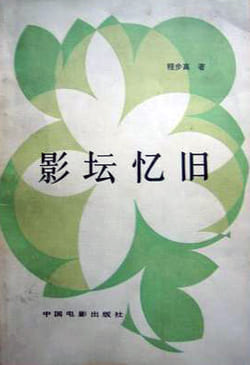
Fac-simile de
l’édition 1983
de ses mémoires |
le-feu étant
intervenu sur pression de la SDN qui conduisit ensuite les
négociations, forçant les Japonais à se retirer et
instaurant une zone démilitarisée à Shanghai et ses abords
immédiats.
|
|