| |
« The
Stars are Bright Tonight » : une œuvre méconnue du duo Xie
Tieli/Bai Hua
par Brigitte Duzan, 16
novembre 2012
|
« Cette
nuit les étoiles brillent » /« The Stars are Bright
Tonight » (《今夜星光灿烂》)
est l’un des premiers films « de guerre » tourné
après la Révolution culturelle.
Réalisé en 1980 par
Xie Tieli (谢铁骊)
d’après un scénario de Bai Hua (白桦),
il représente une style nouveau dans l’histoire de
ce genre de film, une orientation différente qui
correspond au caractère et aux idées du cinéaste
comme de son scénariste, et, plus généralement, à
l’atmosphère de l’époque.
Le combat
des héros anonymes
Un tournant
dans les films militaires chinois
Si « Cette
nuit les étoiles brillent » présente un caractère
innovant dans l’histoire des films militaires en
Chine, c’est parce qu’il ne traite pas la guerre vue
du côté des généraux et des faits d’armes héroïques
des manuels d’histoire ; le film s’attache au
contraire à son |
|
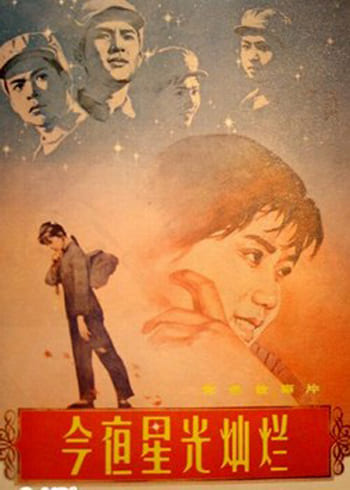
The stars are bright
tonight |
aspect humain,
illustré par de jeunes soldats anonymes de l’Armée de
Libération.
Sans grades
anonymes mais non moins valeureux, ce sont des jeunes de
chair et de sang, prêts au sacrifice, mais aussi capables
d’émotions autres que l’amour de la patrie : ils aiment la
vie et ont des rêves d’avenir.
« Cette nuit les
étoiles brillent » a été réalisé juste après « Little
Flower », ou « Xiao Hua » (《小花》)
de la réalisatrice Zhang Zheng (张铮) ;
outre le fait qu’il a propulsé la jeune
Joan
Chen (陈冲)
au rang des stars les plus populaires de l’époque, « Xiao
Hua » a été le premier film à marquer un véritable tournant
dans les films militaires chinois, en montrant la guerre
sous l’aspect des relations humaines et des sentiments
intimes de personnage pris dans un conflit dont ils ne sont
que des pions.
Produit par le très
officiel studio de l’Armée chinoise, le Studio du 1er
août (1), « Cette nuit les étoiles brillent » poursuit dans
le même esprit un an plus tard. C’est l’un des films
représentatifs de la période 1978-1981 dite
« seconde
période des Cent Fleurs », marquée par un retour aux
thèmes humanistes des années 1960-64.
Une histoire vécue
par Bai Hua
Le scénario est
écrit par Bai Hua (白桦)
aussitôt après sa pièce de théâtre « L’aurore » (《曙光》),
son premier écrit après la chute de la Bande des Quatre (2).
« L’aurore » était
un hommage au général He Long (贺龙)
dont Bai Hua avait été un proche collaborateur au début des
années 1950, et plus particulièrement à l’action menée dans
la région du lac Honghu au début des années 1930 (3).
« Cette nuit les
étoiles brillent » part d’un souvenir plus personnel encore
de Bai Hua : la bataille de Huaihai (淮海战场)
à laquelle il a lui-même participé en tant que soldat,
pendant l’hiver 1948-49. Bataille décisive contre l’armée du
Guomingdang, elle a aussi été particulièrement meurtrière.
Le scénario de Bai Hua est donc indirectement un hommage aux
soldats tombés sur le champ de bataille dont le sacrifice a
permis la victoire ultime des forces communistes.
L’histoire est
celle d’une jeune fille dont le père est maltraité par des
agents du Guomingdang et tué accidentellement alors qu’il
voulait déposer une plainte en justice. Seule et désespérée,
elle tente de se suicider, mais est sauvée in extremis par
un soldat de l’Armée rouge. Les jeunes soldats lui ayant
redonné espoir dans l’avenir, elle entre dans leurs rangs et
finit par remplacer l’un d’eux, mort en mission, en prenant
une part active aux combats.
Un film signé Xie
Tieli
S’il y a une
continuité dans l’œuvre de Bai Hua, il en est de même pour
Xie Tieli : « Cette nuit les étoiles brillent » reprend
l’inspiration thématique de son film de 1964, « Février
printemps précoce » (4), mais nourri des expériences
stylistiques réalisées pendant la Révolution culturelle,
surtout à la fin de la période, avec, en particulier, « La
montagne aux azalées » et « La milicienne de l’île de
Hainan ».
Le film bénéficie
en outre d’une grande complicité entre le réalisateur et le
scénariste, qui ont vécu des expériences très similaires,
ayant tous deux grandi dans les rangs de l’Armée de
Libération, puis étant entrés en même temps dans
l’administration du nouveau régime, la grande différence
étant que Xie Tieli n’a pas été condamné comme droitier et a
même continué sa carrière pendant la Révolution culturelle.
« Cette nuit les
étoiles brillent » représente cependant un hommage partagé
aux soldats tombés au champ d’honneur, mais aussi un
témoignage de l’espoir qu’avait fait naître le Parti
communiste dans les campagnes et de la ferveur patriotique
qu’il suscitait parmi les plus démunis.
Le film s’ouvre sur
des séquences montrant la situation désespérée à laquelle
est réduite l’héroïne Yang Yuxiang (杨玉香)
à la mort de son père. Sauvée du suicide par le jeune soldat
communiste Xiao Yu (小于),
elle est au départ affolée à la vue du cercle de soldats qui
s’est formé autour d’elle, car elle ne fait aucune
différence entre communistes et nationalistes, puis renaît
peu à peu à la vie et à l’espoir.
Cette renaissance
se fait au fil d’un dialogue significatif avec le chef de la
brigade, He Zhanyun (何战云),
auquel a été remis la corde avec laquelle elle voulait se
pendre : ce n’est pas toi qu’on va pendre avec cette corde,
mais Chang Kai-chek, pour libérer tout le pays. Alors,
dit-elle, cela veut dire qu’on peut encore espérer ? Mais
bien sûr, répond He Zhanyun. Et cela va mettre longtemps, de
libérer le pays ? demande-t-elle encore. Ah, cela va
dépendre de l’issue du combat qui se prépare….
Tout est clair : la
victoire dépend de l’engagement de chacun. Le film retrace
alors le parcours sans faille de Yang Yuxiang, de petite
paysanne sans espoir à combattante brave et pure, jusqu’à la
victoire finale. Mais ce n’est pas d’une telle simplicité,
car Xie Tieli s’attache à affiner les sentiments et les
caractères de ses personnages.
Il y a une grande
humanité, et une certaine légèreté dans la peinture de ces
jeunes soldats, idéalistes certes, mais c’est l’idéalisme de
la jeunesse, et, on le sent bien, l’idéalisme qui fut celui
de Xie Tieli et de Bai Hua, comme de toute leur génération.
On sent les personnages vibrer de leurs propres émotions.
C’est d’ailleurs ce
qui va valoir au film une brève campagne de critiques,
fustigeant l’humanisme et les sentiments petits-bourgeois du
film, comme au temps de « Février, printemps précoce ». Mais
les temps ont (provisoirement) changé : au terme d’une table
ronde organisée par la revue ‘Cinéma populaire’ (大众电影),
le film est déclaré « sain » par les représentants du jeune
public, et même par ceux de la Ligue de la jeunesse
communiste.
Le vent est
cependant en train de tourner, cette brève campagne en est
le signe annonciateur. La « deuxième période des Cent
Fleurs » va bientôt s’achever, et c’est un autre scénario de
Bai Hua qui va en faire les frais…
Un film charnière
Le film est surtout
intéressant pour sa recherche stylistique et la peinture de
personnages. Il y a un effort sensible pour alléger le ton
narratif, surtout dans les séquences initiales au front, où
les jeunes soldats sont campés de manière assez vivante,
sinon totalement réaliste. Mais le film reste assez lourd
didactiquement, et n’évite pas les clichés dans la
représentation manichéenne des deux armées, comme dans tous
les films chinois du même genre.
|

Li Xiuming en Yang
Yuxiang |
|
L’aspect
stylistique est le plus réussi. Le film a été
réalisé peu de temps après la publication en 1979 de
l’article fondamental de
Zhang Nuanxin (张暖忻)
et Li Tuo (李陀)
« Sur
la modernisation du langage cinématographique » (《谈电影语言的现代化》) :
partant de la constatation du retard accumulé par le
cinéma chinois depuis 1964, pendant que les cinémas
du monde entier inventaient de nouvelles formes
d’expression, les deux auteurs incitaient les
cinéastes chinois à étudier les théories et les
cinématographies étrangères pour aller de
l’avant
(5). |
Le film de Xie
Tieli se place à cette période charnière et fait quelques
innovations qui étaient mal vues par l’orthodoxie maoïste.
Il renonce par exemple dès l’abord à une narration linéaire
pour raconter en flashes- back l’histoire de la malheureuse
Yang Yuxiang. Il fait aussi usage du rêve pour évoquer ses
craintes, désirs et aspirations, comme une sorte de « flux
de conscience » cinématographique ; le procédé sera repris
l’année suivante par Cen Fan (岑范) dans « La véritable histoire d’AQ » (6).
|
Les
couleurs et la photo sont dans l’ensemble très
belles, en particulier les premières images du film,
montrant Yang Yuxian comme une ombre dans le
lointain. Elles reviennent cependant au style de la
première moitié des années 1960. Le jeu des acteurs
est aussi assez typique de ces années-là, l’actrice
Li Xiumin (李秀明),
dans le rôle de Yang Yuxian, rappelant l’actrice Xie
Fang (谢芳)
interprétant Tao Lan dans « Février, printemps
précoce ».
Le plus
étonnant est le personnage du chef de brigade He
Zhanyun (何战云)
campé par
Tang Guoqiang (唐国强).
C’est cet acteur qui, par la suite, interprétera le
rôle de Mao Zedong dans les films officiels chinois.
Or, son caractère débonnaire,
son
visage souriant, son intimité avec les jeunes
soldats de sa troupe, dans le film de Xie Tieli, en
font un précurseur de ses rôles ultérieurs de
|
|

Tang Guoqiang en He
Zhanyun |
personnification du président, comme récemment dans
« La fondation de la République ».
« Cette nuit les
étoiles brillent » n’est sans doute pas un film majeur dans
la cinématographie de Xie Tieli, mais il permet de mieux
comprendre les films chinois qui vont suivre dans les années
1980. Il est le reflet d’une époque.
Notes
(1) Studio créé en
1951, voir :
L’histoire des grands studios d’Etat.
(2) Sur Bai Hua,
voir
http://www.chinese-shortstories.com/Auteurs_de_a_z_Bai_Hua.htm
(3) Voir
:
« La
garde rouge du lac Honghu ».
(4) Sur ce film,
voir :
http://www.chinese-shortstories.com/Adaptations_cinematographiques_Rou_Shi_Xie_Tieli_
Fevrier_analyse_comp.htm
(5) On mesure le
décalage dans le cas du film étudié, en particulier, quand
on repense à « Apocalypse Now », sorti par Coppola en …
1979 !
(6) Sur ce film
voir :
http://www.chinese-shortstories.com/Adaptations%20cinematographiques_
La_veritable_histoire_AQ.htm
Le film
|
|