| |
« Le
Rêve dans le Pavillon aux pivoines », de Xu Ke :
Un
sommet de l’art de Mei Lanfang
par Brigitte
Duzan, 31 décembre 2008, révisé 12 mai 2020
|
Film de
1960, « Le Rêve dans le Pavillon aux pivoines » (《游园惊梦》)
est adapté d’un extrait du grand classique du
théâtre chinois « Le Pavillon aux Pivoines » ou
Mudan ting (《牡丹亭》).
Pièce
écrite en 1598, à la fin de la dynastie des Ming,
par le dramaturge Tang Xianzu (汤显祖),
elle a rarement été interprétée car, outre le fait
qu’elle a été longtemps interdite, elle dure près de
vingt heures. Mais c’est un monument de la
littérature chinoise.
Le film de
Xu Ke (许珂)
met en
scène l’adaptation en opéra
kunqu de
la scène la plus
célèbre et la plus souvent représentée, avec Mei
Lanfang dans le rôle principal. C’est une
interprétation historique, à beaucoup de points de
vue.
1. La
pièce et son auteur
L’auteur
|
|

Le Rêve dans le
Pavillon aux pivoines, 1960 |
« Le Pavillon aux
Pivoines » (《牡丹亭》)
est
l’œuvre de Tang Xianzu (汤显祖),
né dans le Jiangxi (江西),
à Linchuan (临川),
en 1550. En 1577, il va à la capitale passer une première
fois les examens mandarinaux, mais échoue deux fois et
devient finalement ce que l’on appellerait aujourd’hui
un ministre sans portefeuille. En 1591, il écrit une
première pièce qui critique la maison impériale et ses hauts
fonctionnaires : il est exilé dans une lointaine province.
|
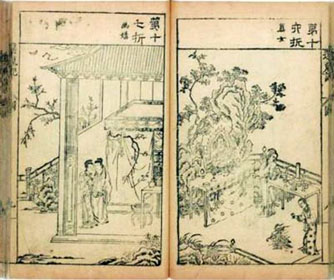
Le rêve dans le
jardin, livre illustré |
|
Il
démissionne en 1598 et retourne chez lui, à
Linchuan, pour se consacrer à l’écriture. Il écrit
alors, entre autres, les quatre pièces qui l’ont
rendu célèbre et qui, parce qu’elles comportent
toutes une histoire de rêve, sont regroupées sous le
titre « Les quatre rêves de Linchuan » (《临川四梦》),
la plus réussie étant certainement « Le Pavillon aux
Pivoines ».
Il meurt en 1616, la même année
que Shakespeare auquel il est souvent comparé : on
l’appelle le « Shakespeare chinois ». L’histoire
officielle des Ming, publiée au 18e
siècle
,
lui consacre bien une notice biographique, mais elle
|
passe ses écrits sous silence,
rapportant seulement les attaques tirées de sa
correspondance contre les ministres de son époque
.
La
pièce
La pièce entière est non seulement très
longue, mais c’est aussi une œuvre difficile à mettre en
scène, qui a rarement été jouée dans sa totalité. Elle est
cependant considérée comme un chef-d’œuvre de la littérature
chinoise, une sorte de modèle de l’amour parfait, et une
œuvre raffinée d’une extrême complexité. On raconte que,
vers la fin des Ming, lorsque la pièce a été interprétée
quelques rares fois dans son intégralité, des femmes sont
tombées en pâmoison à la fin de la représentation. La pièce
a ensuite exercé une influence considérable sur les esprits
dès le début du 17e siècle.
La pièce raconte
en effet l’histoire d’une jeune femme, Du Liniang (杜丽娘),
fille d’un haut fonctionnaire des Song du Sud, tombée
amoureuse d’un jeune homme, Liu Mengmei (柳梦梅),
qui lui est apparu en songe alors qu’elle s’était endormie
sous un saule au cours d’une promenade dans le jardin
familial. Condamnée à un amour impossible, elle meurt de
tristesse. Mais le juge des enfers, constatant la force de
son amour, estime qu’il était prédestiné et lui permet de
revenir sur terre. Son fantôme étant apparu à Liu Mengmei,
celui-ci accepte d’exhumer son cadavre. Elle revient alors à
la vie. Reste à convaincre le père de Du Liniang,
fonctionnaire aux idées étroitement confucéennes, qui ne
croit pas aux miracles et considère Liu Mengmei comme un
pilleur de tombes et un imposteur. Fort heureusement, le
jeune homme arrive en tête aux examens impériaux, ce qui
vaut aux deux amants la grâce impériale. Du Liniang rentre
dans le rang et devient épouse exemplaire…
|
L’œuvre
est d’abord une allégorie sur le pouvoir des
sentiments, le
qíng
(情),
une romance intemporelle magnifiant la force de
l’amour. Mais, plus profondément, c’est aussi une
allégorie sur le pouvoir du rêve et les troubles nés
de l’illusion. Les deux jeunes doivent prouver
l’authenticité de leur existence et de leur
identité, et la réalité de leur amour. C’est une
réflexion d’inspiration taoïste sur le vrai et le
faux, ou le réel et l’illusoire, un jeu sur les
limites factices entre le
zhēn
(真)et le
jiǎ
(假)
.
|
|

Du Liniang et Liu
Mengmei (livre illustré) |
Mais, comme la
pièce de Shakespeare « Roméo et Juliette », c’est en outre
une célébration de l’amour comme force capable de s’élever
contre la rigidité des conventions sociales. La pièce a
suscité la controverse dès sa publication par les idées
qu’elle comporte, en particulier sur les femmes et le
mariage. A une époque où les femmes devaient adopter une
attitude de soumission, l’héroïne de Tang Xianzu est une
jeune fille volontaire qui s’échappe avec sa soubrette pour
aller se promener dans le jardin et préfère mourir plutôt
que d’abandonner l’amour obsessif qui lui est venu en songe.
La pièce est une attaque contre une société conservatrice où
non seulement les mariages arrangés étaient une des bases de
l’organisation familiale, et donc sociale, mais où la norme
était dictée par un néoconfucianisme de style répressif,
connu sous le terme de daxue, qui mettait l’accent
sur les formes extérieures de comportement social : il
fallait vivre « selon le livre ».
Tang Xianzu
emprunte au bouddhisme et au taoïsme des concepts propres à
lutter contre l’emprise du néo-confucianisme sur lequel
s’appuyait l’empereur pour assurer l’ordre social. « Le
Pavillon aux Pivoines » est un chef-d’œuvre subversif à bien
des points de vue, mais qui, ironiquement, rétablit l’ordre
en fin de compte.
2. L’opéra
Vu sa
longueur, la pièce a rarement été représentée dans son
intégralité ; elle est restée surtout une pièce « à lire »
.
Mais, dès le vivant de Tang Xianzu, des extraits des scènes
les plus célèbres ont été adaptés en opéra, et en
opéra
kunqu (昆曲)
car c’était la forme d’opéra la plus raffinée, la plus en
vogue dans les familles de lettrés de la fin des Ming qui
disposaient de troupes pour l’interpréter. C’est un opéra
qui donne traditionnellement la priorité à la peinture de
sentiments nobles et élevés, à des histoires d’amour
tragique ; son raffinement est à apprécier tant du point de
vue musical que littéraire.
Né au
milieu du 16ème siècle à Kunshan, près de Suzhou, le
kunqu est l’une des plus anciennes formes d'opéra
chinois dont on peut dire, de manière schématique, qu’il
correspond à une étape de développement de l’opéra chinois
venant parachever deux genres précédents : le nanqu (南曲),
né sous les Song du Sud au 12ème siècle, mais qui
connut un nouvel essor sous les Ming avec des pièces de type
chuanqi consacrant le style du sud, et le yuanqu
(元曲),
né un siècle plus tard sous les Yuan, qui comportait, lui,
des passages chantés sur des mélodies du nord. Le kunqu
est donc en quelque sorte la synthèse des deux.
Et cette synthèse
est l’œuvre d’un musicien de Kunshan nommé Wei Liangfu
(魏良輔)
auquel un dramaturge confia un jour l’une de ses pièces pour
en faire un opéra. La pièce eut tellement de succès que Wei
Langfu décida d’adapter dans le nouveau style qu’il venait
de créer les œuvres célèbres de son temps, et en particulier…
« Le Pavillon aux pivoines ».
Il y
a donc dès l’origine une affinité particulière entre cet
opéra et la pièce de Tang Xianzu.
L’une des
caractéristiques du kunqu est la place prépondérante
qu’y occupent la musique et le chant, celui-ci écrit en vers
d’une grande finesse dans l’évocation des sentiments des
personnages. Le chant fait vraiment partie intégrante de
l’action, essentiellement concentrée sur les rebondissements
d’une histoire d’amour, à l’exclusion de tout récit
picaresque ou violent. Ainsi, dans « Le Pavillon aux
pivoines », le chant domine les trois grandes scènes qui
structurent le récit : le rêve de Du Liniang, sa maladie et
le dialogue de Liu Mengmei avec son portrait.
La musique est
confiée à un orchestre divisé en trois groupes
d’instruments, percussions, vents et cordes, où les
percussions sont prédominantes, marquant la mesure, mais
aussi ponctuant les voix et les gestes des acteurs pour
souligner les sentiments des personnages. L’instrument
directeur est le
bǎngǔ
(板鼓)mais
les cliquettes
pāibǎn
(拍板)donnent le son caractéristique qui donne le tempo et
marque les temps de respiration dans le chant ou la
déclamation. Les instruments à vent accompagnent le chant
tandis que les cordes créent l’ambiance
.
Aux 17e
et 18e siècles, le kunqu était considéré
comme le summum de l’art de la scène et on applaudissait aux
arias accompagnés des mouvements typiques des longues
manches de soie blanche qui forment une sorte de
calligraphie stylisée. Mais, trop raffiné pour le public
ordinaire, ce style d’opéra tomba en désuétude au 19e
siècle. La révolte des Taiping (1851-1854) lui porta un coup
décisif, les troubles que connut alors la Chine entraînant
la désagrégation des troupes qui ne pouvaient plus circuler
dans le pays. Le public et les auteurs se tournèrent ensuite
vers une nouvelle forme d’opéra qui était à la fois plus
facile et plus spectaculaire : l’opéra de Pékin.
L’opéra kunqu
a ensuite été interdit comme les autres pendant la
Révolution culturelle, et il n’a connu qu’une très lente
renaissance à partir du début des années 1980.
Le
18 mai 2001, il a
été classé par l'Unesco chef-d'œuvre du Patrimoine oral et
immatériel de l'humanité, mais c’était un chef d’œuvre en
voie d’extinction. Les maîtres avaient alors plus de
soixante ans, et les quelques écoles qui l’enseignaient
n’attiraient qu’un faible nombre d’étudiants.
Comme
le caractère
昆
kūn
se prononce, au ton près, comme celui qui signifie
« somnoler » (困 kùn),
les Chinois l’appelaient avec humour « l’opéra somnolent ».
Les livrets étaient difficiles à comprendre, le tempo était
lent, cela manquait de mouvement et d’acrobaties.
Il a connu
cependant un essor remarquable après cette date, et l’œuvre
qui a contribué sans doute le plus à son nouvel élan fut
justement… « Le Pavillon aux Pivoines » !
3. Le film de Xu
Ke
| |
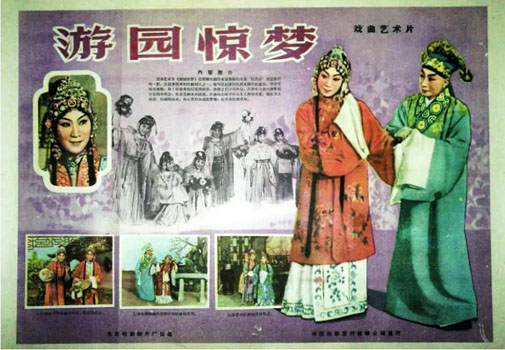
Affiche promotionnelle |
|
Le film de
Xu Ke (许珂)
« Le Rêve dans le Pavillon aux pivoines » (《游园惊梦》)
est en fait l’adaptation de la scène la plus célèbre de la
pièce de Tang Xianzu : « Le rêve interrompu » (惊梦),
scène qui se déroule au cours de « la promenade dans le
jardin » (游园),
d’où le titre, en deux parties.
Hommage à Mei
Lanfang
|

Mei
Lanfang dans le rôle de Du Liniang et
Yu
Zhenfei dans celui de Liu Mengmei
(interprétation traditionnelle) |
|
Nous
sommes ici dans la tradition établie sous les Qing
des zhezixi (折子戏),
c’est-à-dire de répertoires de troupes d’opéra
constitués de pièces courtes à partir des scènes les
plus réussies de pièces choisies. La scène du rêve
interrompu est celle qui a inspiré le plus
d’adaptations.
Le
tournage a commencé à la fin de 1959 et a été
terminé début janvier1960. Ce n’était pas Xu Ke, à
l’origine, qui devait réaliser le film, prévu dans
le cadre d’un projet ambitieux, soutenu par le
premier ministre Zhou Enlai, qui visait à réaliser
plusieurs films d’opéra avec Mei Lanfang (梅兰芳)ainsi
que l’autre célèbre spécialiste des rôles de dan
de l’époque, Cheng Yanqiu (程砚秋).
|
|
Le
réalisateur initialement prévu était le dramaturge
et cinéaste
Wu Zuguang (吴祖光),
qui avait réalisé plusieurs documentaires sur
l’opéra en 1955 et 1956, dont un long film, en deux
parties, coréalisé en 1955 avec Cen Fan (岑范) :
« L’art de Mei Lanfang » (《梅兰芳舞台艺术》).
Or Wu Zuguang fut condamné comme droitier en 1957.
« Le Rêve dans le Pavillon des pivoines » échut donc
à Xu Ke, qui présentait toutes les garanties
politiques.
Du
Liniang : rôle clé de Mei Lanfang
Il faut
considérer le film comme un nouveau documentaire sur
l’art de Mei Lanfang, ici dans le rôle de Du
Liniang, rôle-type de "guī
mén dàn"
(闺门旦),
c’est-à-dire la jeune fille qui n’est pas encore
mariée et donc qui, théoriquement, ne doit pas
franchir seule la porte de sa chambre, ou des
appartements des femmes (闺门).
C’est donc une jeune fille |
|

Mei
Lanfang dans le rôle de
Du
Liniang dans le film |
immature,
surveillée par sa mère, qui est, elle, un rôle du genre
huādàn
(花旦)
ou
qīngyī
(青衣).
|
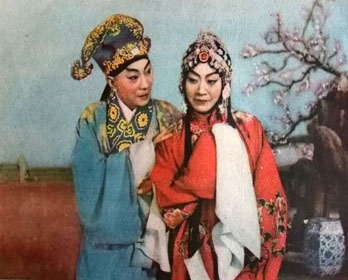
Yu Zhenfei et Mei
Lanfang dans le film |
|
Le rôle de
Du Liniang a marqué les débuts de la carrière de Mei
Lanfang au cinéma.
Dans un essai sur la genèse du film de Xu Ke, Mei
Lanfang évoque la première fois où il a tourné un
extrait du « Pavillon aux pivoines » : c’était en
1920 ; il interprétait un épisode de la scène 7
(L’école des femmes 闺塾),
celui où la malicieuse petite servante Chunxiang (春香)
se livre à des espiègleries pendant la leçon du
précepteur (Chunxiang dérange la leçon 春香闹学).
|
|
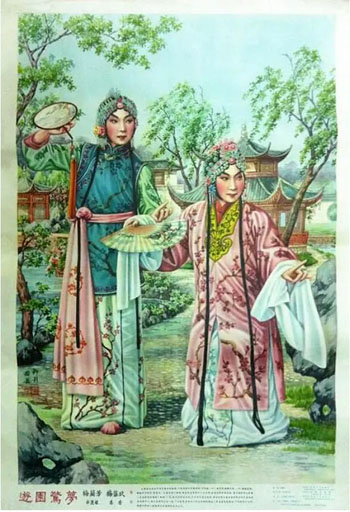
Du Liniang et
Chunxiang dans le film de Xu Ke |
|
Pendant les quarante années qui séparent cette
première interprétation du film de 1960, le kunqu a
servi de terrain d’expérimentation à Mei Lanfang, et
en particulier le rôle de Du Liniang. Pour sa
dernière interprétation,
en 1960,
en
collaboration avec son chorégraphe et théoricien Qi
Rushan (齐如山),
il a mis au point, pour la scène du rêve, une
chorégraphie spéciale du moment crucial : « la
rencontre des regards » (dui yanguang 对阳光 ou dui
yanshen 眼神).
Mais toute la gestuelle, très lente, accompagnant
les modulations raffinées du chant et les pas comme
en apesanteur de la promenade sont le résultat de
quarante ans de travail d’abstraction progressive.
|
La scène du rêve
dans le jardin :
la rencontre avec
Liu Mengmei (rencontre des regards)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=wD-OmIVpCtg&feature=emb_logo
Du Liniang
est aussi le premier rôle que Mei Lanfang a interprété sur
scène après avoir refusé de jouer pendant toute l’occupation
japonaise : il marque son retour sur scène, en octobre 1945,
à Shanghai. C’est le rôle dans lequel il excellait. En 1960,
c’était le summum de son art. Il est mort l’année suivante.
Interprétation
historique et passage de relais
|
Le film
marque ainsi un passage de relais. Aux côtés de Mei
Lanfang, le rôle de Liu Mengmei est interprété par
son vieil ami et disciple Yu Zhenfei (俞振飞),
et celui de la petite servante Chunxiang par la
grande actrice, élève de Mei Lanfang, Yan Huizhu (言慧珠).
C’est elle qui, après la mort du maître,
interprétera le rôle de Du Liniang, aux côtés de Yu
Zhenfei ! C’est la fin des rôles féminins de
kunqu interprétés par des acteurs masculins. Le
film de 1960, en ce sens, marque un tournant : fin
d’une époque, il en annonce une autre.
En même
temps, c’est un film superbe. Il faisait partie d’un
projet en hommage à l’art de Mei Lanfang : le
réalisateur s’est effacé devant l’artiste, en
soignant le côté visuel, avec costumes et décors aux
somptueuses couleurs pastel, légèrement sépia.
|
|

Héritiers : Yan Huizhu
et Yu Zhenfei dans
les rôles de Du
Liniang et Liu Mengmei |
« Le Rêve dans le
Pavillon aux pivoines » est un chef d’œuvre historique au
charme indicible.
Le film est
maintenant sur internet :
https://www.bilibili.com/video/av21307152/
[article initial à
la suite de la projection du film à la Cinémathèque de Paris
le 7 décembre 2008]
En complément
On peut mettre en
parallèle le film de
Yonfan
(杨凡)
« Le
Pavillon aux pivoines » (《游园惊梦》)
qui, bien que portant le même titre chinois, est plutôt un
rêve sur la pièce, et non une adaptation stricto sensu.
|
|