| |
« Le
paon » : coup d’envoi, coup de maître de Gu Changwei
par Brigitte Duzan, 16 juin
2012
|
« Le paon »
(ou « Peacock »《孔雀》)
est le premier film réalisé par
Gu Changwei (顾长卫), jusque là connu comme chef opérateur des grands réalisateurs de la
cinquième génération. Sorti au festival de Berlin en
février 2005, il a été couronné de l’Ours
d’argent/Grand prix du jury.
Une
histoire de rêves frustrés
Le film
raconte l’histoire de trois enfants d’une famille
pauvre d’une petite ville du Henan, à la fin des
années 1970 et dans la première moitié des années
1980, c’est-à-dire au tout début de la période
d’ouverture après la mort de Mao. Elle se déroule
donc en trois parties, reliées entre elles par une
scène récurrente qui montre la famille en train de
manger.
Le film
commence par la sœur cadette, pleine de vitalité et
d’entrain, la tête pleine de rêves qu’elle vit comme
elle peut : en traînant |
|
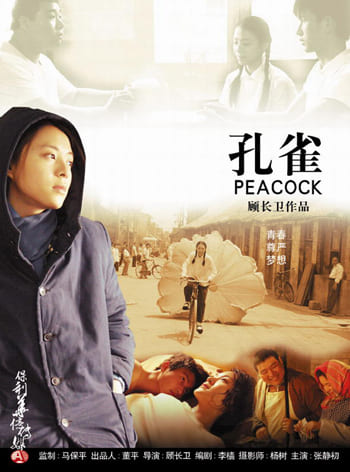
Le paon (Peacock) |
derrière sa
bicyclette un immense parachute troué en s’imaginant être la
parachutiste qu’elle ne sera jamais, mais qu’elle rêve
d’être par amour pour un parachutiste tombé dans un champ,
un beau jour d’été.
|

Le frère aîné |
|
Le frère
aîné, 23/24 ans, a eu, enfant, une maladie qui l’a
laissé légèrement retardé mental ; obèse, incapable
de mener une vie normale, il est constamment la
cible de plaisanteries autour de lui et l’objet des
attentions familiales.
Quant au
petit frère, 17/18 ans, qui est aussi le narrateur,
c’est un enfant timide et renfermé, qui a honte de
son frère aîné et que son père finit par mettre à la
porte. Il reviendra marié, avec une chanteuse plus
âgée que lui. |
Finalement, c’est
le frère aîné qui aura le sort le plus heureux, montrant
qu’il n’était pas si attardé que l’on pensait et réussissant
à monter une petite affaire familiale en surfant sur la
vague de la réforme économique : image vaguement ironique de
la Chine qui décolle et s’enrichit.
Le film durait à
l’origine près de quatre heures. Réduit à 144 minutes pour
les besoins de l’exploitation en salle, il a souffert des
coupes imposées, la dernière partie, en particulier, qui ne
fait plus qu’une petite demi-heure. Mais il reste une
réussite à tous points de vue.
La vie comme elle
vient
|
Gu Changwei
est ici plus proche des réalisateurs de la sixième
génération que de la cinquième. Il a abandonné les
grandes fresques symboliques des seconds, auxquelles
il a d’ailleurs participé en tant que chef
opérateur, et opté pour une approche réaliste de la
vie quotidienne telle qu’il l’a lui-même vécue, et
donc différente aussi des analyses de l’aliénation
du monde moderne type Jia Zhangke.
Cette
réalité quotidienne est aussi celle qu’a vécue le
scénariste lui-même, Li Qiang (李樯)
(1), qui a situé l’histoire dans son Henan natal, au
nord de la province, exactement, dans le district
d’Anyang (河南安阳).
Gu Changwei
a expliqué qu’il voulait « laisser la vie se
dérouler aussi naturellement que possible »,
privilégiant pour cela une structure en plans
séquences pour coller le plus possible à la vie de
ses personnages, des personnages qu’il a voulus
ordinaires, « comme des milliers d’autres au même
moment ». |
|

Zhang Jingchu dans «
Le paon » |
|

Les deux cadets (Zhang
Jingchu et Lü Yulai) |
|
Mais ce
sont des personnages qui ont des rêves, qui vivent,
adolescents, de ces rêves, jusqu’à ce qu’ils se
fracassent sur la réalité quotidienne de l’âge
adulte. Le seul qui réussit à sortir de la misère
ambiante est celui, justement, qui n’en avait pas,
mais dont l’esprit pratique lui permet de créer une
petite affaire à la mesure de ses ambitions très
pragmatiques. Gu Changwei dresse un portrait lucide
de sa génération, en semblant remiser le rêve au
rayon des accessoires périmés.
|
Ce n’est cependant
qu’une apparence. Le message du film, comme du scénario, est
que «
nombreux sont ceux qui tentent de réaliser leurs idéaux mais
sont frustrés par la réalité. … Ils ne peuvent échapper aux
contraintes exercées par la médiocrité de leur vie ;
néanmoins, leur existence tranquille, mais tenace, est aussi
digne de respect que celle de ceux qui ont accompli des
faits héroïques. »
|
La dernière
séquence est à lire dans cette optique ; elle
retrouve un ton symbolique pour achever le film en
soulignant l’importance des aspirations à un monde
meilleur et de la quête de la beauté dissimulée en
toute chose : c’est le sens de l’image finale d’un
paon révélant in fine les trésors colorés de sa
queue, qu’il tenait obstinément cachés aux yeux de
ses spectateurs. On retrouvera cette idée comme
thème principal du film suivant, « Lichun »
(《立春》). |
|

L’image d’un rêve |
Il est synthétisé
dans la chanson qui est le thème musical du film (3) :
“心比天高,命比纸薄,千金之身落了雀巢”
L’esprit vole plus haut que le ciel, le destin est plus fin
qu’une feuille de papier,
Tout l’or
de l’existence est contenu dans un nid de moineaux.
|
Gu
Changwei se révèle ici réalisateur plein d’humanité.
« Sous les pavés la plage », disait le célèbre
graffiti de 1968. C’est un peu cela, chez Gu
Changwei : la vie ordinaire semble banale, mais la
vie, en elle-même, est formidable. Et ce thème-là
structure toute son œuvre, dont son court métrage de
2012 :
« Long
Tou » (《龙头》).
Un mot sur
les acteurs et la photo
Les acteurs |
|

L’autre image d’un
rêve |
|

Le scénariste Li Qiang |
|
Avec ce
film, Gu Changwei s’est montré remarquable directeur
d’acteurs : acteurs déjà accomplis comme Huang
Meiying (黄梅莹),
grande actrice des années 1980, interprétant la mère
avec une sensibilité retenue, ou acteurs nouveaux
comme Feng Li (冯瓅)
dans le rôle du frère aîné.
Mais « Le
paon » a aussi révélé deux acteurs formés à
l’Institut d’art dramatique, qui feront ensuite une
brillante carrière : Zhang Jingchu (张静初)
dans le rôle de la sœur
et Lü Yulai (吕玉来) dans celui du petit
frère. On a vu la première |
récemment dans
« Aftershock »
(《唐山大地震》) de
Feng Xiaogang (冯小刚),
et le second est devenu populaire grâce à son rôle suivant,
dans
« Le
dernier voyage du juge Feng » (《马背上的法庭》),
en 2006.
Le chef opérateur
Il faut enfin
souligner le travail fait sur la photo, nimbée dans les
brumes du souvenir, en parfaite symbiose avec l’univers de
Gu Changwei et de son scénariste. Elle est signée Yang Shu (杨述), chef opérateur peu prolixe, né en 1963, qui, avant « Le paon », avait
signé en 1997 la photo du second film de
Wang Xiaoshuai (王小帅),
« Frozen » (《极度寒冷》).
Le film (partie A)
Le film (partie B)
Le film (partie C)
Le film (partie D)
Le film (partie E)
Le film (partie F)
Notes
(1) Sorti de
l’institut d’art dramatique en 1992, Li Qiang (李樯)
est devenu scénariste professionnel en 1995.
Il a écrit pour le théâtre et la télévision avant de
se consacrer aux scénarios de cinéma. Il a mis sept ans à
peaufiner le scénario du « Paon » ; il a ensuite également
été le scénariste du second film de Gu Changwei, « Lichun »
(《立春》),
mais aussi du film de 2007 d’Ann
Hui
(许鞍华),
« The Postmodern Life of my Aunt » (《姨妈的后现代生活》).Interviewé
sur Phoenix TV, il a expliqué son style en une phrase : la
réalité est impitoyable, je n’y peux rien (现实是残酷的,我不会慰安).
Mais les
gens simples qui ne laissent aucune trace dans l'histoire
sont les gens avec qui il sympathise… et avec lesquels
sympathise Gu Changwei.
Interview
:
http://www.china.com.cn/chinese/CU-c/1247549.htm
(2) La musique du
« Paon » est signée Peng Dou, qui a également signé celle de
« Together » (《在一起》), le documentaire de
Zhao Liang (赵亮)
qui est l’œuvre « jumelle » du troisième film de Gu Changwei
« Love
for Life » (《最爱》).
La chanson du
« Paon » débute comme une paraphrase du Hongloumeng
(Le rêve dans le pavillon rouge)
|
|